Forêt amazonienne, 1752.
La canopée retient la brume grisâtre comme à chaque journée naissante. Les animaux de la nuit terminent leurs vocalises pour faire place aux piaillements des perruches jaunes ou bleues, agrémentés de la danse désordonnée de flamboyants papillons. La jungle se réveille, moment le plus agréable dans cet environnement hostile, la température est encore supportable.
Bientôt, la chaleur provoquera l’évaporation des pluies, et engendrera la sensation d’évoluer dans une étuve étouffante. Les oiseaux s’affairent avant que la moiteur ne les contraigne à se protéger des rayons brulants. Leurs ailes bigarrées font naitre des arcs en ciel et leurs sifflements excités résonnent dans la vallée. Les prédateurs nocturnes disparaissent, laissant le terrain de chasse aux reptiles que la douceur ranime lentement. Tous les matins, à peine durant une heure, ce rituel du renouveau se déroule devant les yeux des explorateurs qui ne s’en lassent pas, découvrant sans cesse une nouvelle espèce aux teintes et aux mélodies encore inconnues la veille.
C’est le moment contemplatif de la journée qu’ils ne ratent jamais, car dans les heures qui vont suivre, ils subiront les assauts du soleil ou des pluies tropicales, et lutteront contre les courants dans une atmosphère suffocante, garnie d’insectes, plus agressifs les uns que les autres.
Orellana, bercé par ces échos désormais familiers, a une migraine extraordinaire ce matin, et se dit que d’avoir voulu goûter à l’alcool que bricolent ses hommes s’était avéré une grave erreur. Il ne participait que rarement aux fêtes de ses compagnons, en tant que chef, il s’imposait l’obligation de demeurer digne, et veillait à rester en pleine possession de ses capacités. Pourtant, cette fois, il les avait honorés de sa présence pour leur prouver qu’il partageait leur condition et souhaitait ainsi soutenir le moral de ses troupes.
Il ne l’avait pas regretté, le repas avait été excellent. Les gaillards étaient devenus de fins cuisiniers, maîtrisant à présent la préparation des différents produits qu’offrait la forêt. Dommage que leur fierté d’Occidentaux et de conquérants prétentieux ait retardé le moment où ils acceptèrent de suivre les conseils des Indiens rencontrés sur le fleuve. Beaucoup auraient évité de mourir de faim et de maladies, s’ils avaient daigné apprendre à pêcher ou à reconnaître les plantes comme leur suggéreraient les rares autochtones alliés.
Le lieutenant, lui, avait rapidement compris que si ces petits hommes survivaient au cœur d’une nature aussi dangereuse, ils pouvaient en faire de même, en adaptant leurs préceptes aux coutumes des sauvages.
La modeste troupe avait dégusté du paca, une sorte de rongeur, ainsi que du caïman qu’ils avaient cuit dans le citron. Ils terminaient les repas par un mélange des fruits récoltés sur leur chemin. C’est ce bon moment autour du feu qui l’avait incité à traîner avec la bande, et à boire un peu plus que de raison.
Des singes hurleurs débutèrent un concert improvisé. Les Espagnols ne s’affolaient plus de ces lamentations qui montaient de la vallée et que l’écho amplifiait. Ces chants lugubres détenaient le pouvoir de glacer le sang, même une fois identifié.
— Eh, Rodrigue ! Tu te souviens quand on te faisait gober que la voix de ces primates était celle du diable qui nous poursuivait ? Le plus dévot des franciscains n’est jamais parvenu à débiter autant de prières que toi à l’époque, se moqua un rude barbu qui luttait contre des lianes à grands coups de sabre.
Le gars concerné haussa les épaules, il savait pertinemment que l’autre se vantait parce qu’il avait participé à la première exploration du lieutenant, démasquant avant lui les mystères de ces contrées. Il n’était probablement pas beaucoup plus fier que lui, la première fois qu’il entendit ses chants d’outre-tombe.
— Continue de jouer au mariole, Orlando, moi au moins, je ne crains pas les anacondas. Toi, tu cries comme une fillette quand tu en repères un, alors que tu vis dans ces forêts depuis des années. Rien qu’avant-hier, je suis intervenu pour en faire fuir un. Tu étais paralysé à sa vue, pareil qu’une souris. Puisque ça t’amuse de te moquer de moi, à la prochaine occasion, je te laisserai te débrouiller seul avec tes amis reptiles. Rira bien, qui rira le dernier !
Un couple d’aras s’envola en vociférant, contrarié par le vacarme. Le bruyant chamaillage de deux hommes, que la vallée amplifiait, aggravait le mal de cheveux d’Orenalla.
— Soyez assez aimables de vous engueuler en silence, les gars. Pablo, qu’avais-tu encore mis dans tes cigares puants d’hier ? Ma tête sonne comme une pastèque vide, demanda Orenalla.
— Rien de différent. Comme d’habitude lieutenant. Je les fabrique de la même façon que me l’ont montré les tribus du fleuve. Moi, je peux vous assurer que ça ne m’a pas fait plus d’effet que de coutume. Sûrement, en avez-vous abusé ? Et puis, ce nouvel alcool, le rhum comme vous l’appelez, ne semble pas faire bon ménage avec mes plantes. Or vous paraissiez l’apprécier particulièrement hier soir, lieutenant.
— Mouais… j’ai du mal à te croire… ou tu t’es encore trompé dans tes dosages.
Ses douleurs de crâne venaient du tabac hallucinogène que l’espagnol avait découvert au cours de ses expéditions. Ces sortes de cigares, formés de feuilles roulées, étaient composés de diverses essences, cependant, les autochtones y glissaient des plantes aux vertus spectaculaires, en plus ou moins grandes quantités selon l’effet recherché. Les Indiens les consommaient le soir autour des feux protecteurs en racontant des légendes aux plus jeunes. Ils prétendaient pouvoir communiquer avec les esprits de la forêt qui les conseillaient dans leurs choix à travers les fumées. Les actions des tribus découlaient invariablement de la consultation de ces génies. Leurs sorciers, les chamans, avaient pour tâche d’entrer en relation avec ces divinités, et concoctaient ces cigares qu’ils conservaient au coin des lèvres toute la journée.
Les explorateurs avaient appris à les confectionner. Seulement, ils confondaient parfois les ingrédients et chargeaient les cigarettes en psychotropes. Quoiqu’il en soit, ils y avaient pris goût au cours de ces interminables années à errer dans la jungle. Ces substances aidaient à oublier les douleurs occasionnées par les longues luttes avec la nature ou la mouvance des rivières. Et puis, il consommait ce nouvel alcool : le rhum. Des chercheurs d’or rencontrés au fil de l’eau leur avaient fait goûter. Ils avaient expliqué qu’ils l’avaient découvert lors d’escales à Os Barbudos[1], et le créaient à partir des cannes à sucre que les colons-agriculteurs, installés plus au Sud, récoltaient en grande quantité.
C’était fort et âpre, mais c’était le seul alcool qu’ils étaient parvenus à fabriquer.
L’officier se décida à soulever une paupière. La récréation avait assez duré à son goût. Les hommes étaient épuisés et n’auraient pas demandé mieux que de continuer à se reposer, mais le retard croissait et le début de la saison des pluies imposera bientôt de stopper leurs recherches. Cela ne devrait plus tarder. Les trombes d’eau provoqueront des courants si violents que même ces rameurs accomplis ne seront pas capables de les dominer et les contraindront à renoncer.
— Avez-vous vu la fille depuis l’aube ? interrogea-t-il le pilote de l’embarcation.
— Non, elle a disparu depuis deux jours.
— Elle ne se cache sûrement pas bien loin… elle nous accompagne depuis des semaines… elle n’aurait aucune raison de s’évanouir après un tel entêtement.
Les cris des perroquets irrités attirèrent son attention vers l’arrière du bateau. S’appuyant sur les coudes, il se souleva péniblement pour se rafraîchir le visage dans l’onde. Le cours d’eau charriait tant de terre qu’il était d’un rouge opaque, et même à cette heure matinale, il était déjà chaud. Ayant retrouvé un peu de lucidité, il regarda autour de lui.
C’est à ce moment qu’il la découvrit sous une cascade, en avant des embarcations. Elle se tenait dans le soleil montant, ce qui éblouissait les rameurs et rendait difficile la possibilité de détailler sa physionomie. Nonobstant, elle paraissait jeune, il pouvait entrevoir son ventre plat et affirmer que sa poitrine affichait encore de la fermeté.
Les grossesses à répétitions et la vie rude déformaient très tôt la silhouette des femmes de la forêt amazonienne. Or ce corps quasi nu exhibait des formes parfaites. Orenalla n’avait jamais eu le loisir de la discerner nettement, c’était un fantôme qui surgissait de n’importe où pour s’évanouir aussi vite. Tout de même, il avait pu l’observer tant de fois furtivement qu’il avait constaté qu’elle ne présentait pas le profil amérindien : trop blanche, trop grande. De longs cheveux châtain clair qui viraient au blond selon l’angle de la lumière indiquaient qu’elle n’était pas autochtone. Ce matin, tout le monde la voyait, ce n’était donc pas un mirage produit par l’excès de drogues naturelles.
Cette silhouette de nymphe ravivait des souvenirs issus de son expédition précédente. Néanmoins, son cerveau embrumé n’arrivait pas à en raccorder les bribes. Ça commençait à dater, c’était très loin d’ici, tellement loin que c’était incohérent. Ils étaient à mille lieues de concevoir les maladies dégénératives, les Espagnols se contentaient d’imaginer que c’était la fatigue et le poids des années qui provoquaient les pertes de mémoire de leur chef.
Orellana avait voué son existence à ce pays pour en percer les mystères. Était-ce vraiment l’âge qui entamait sa mémoire ou les fièvres que propageaient tous les insectes de ces contrées ? En tout cas, l’espagnol rencontrait de plus en plus de difficultés à différencier les réalités des mythes qu’il avait récoltées en écoutant durant des heures les récits des chamans.
Cette fois, c’était elle, pas de doute possible. Il l’apercevait sur les hauteurs, debout sur un promontoire au-dessus de la chute. Elle paraissait attendre. Son attitude arrogante narguait la troupe à la voir empêtrée dans les herbages. La végétation luxuriante entravait la progression des pirogues. Les skifeurs râlaient à s’emmêler sans cesse dans les herbes à fleur d’eau.
Si ramer contre des courants faibles en cette fin de saison sèche se montrait plus simple, la contrepartie était que le niveau des eaux, fort bas, laissait ressortir toute sorte d’obstacles : troncs immergés, branches dans lesquels les pagaies venaient buter sans arrêt, sans omettre cette sorte d’herbe qui s’entortillait partout.
Cette vision finit de réveiller l’officier qui conspua ses hommes.
— Là-bas ! Vous la voyez ?
— Oui, mon lieutenant, seulement, elle est vachement loin.
— Eh bien, allez les garçons ! Avançons, hors de question de la perdre, bougez-vous !
Les gaillards se battaient autant qu’ils le pouvaient avec les lianes qui dégringolaient des arbres comme une pluie tropicale. Ils bataillèrent un long moment, coupant à la machette en tous sens. Malgré la relative fraîcheur du matin, ils ruisselaient déjà, des traînées de sueur coulaient sur leurs dos, se mêlant à l’humidité omniprésente. Les coups de sabre provoquaient des ripostes de la part des habitants des feuillages. Les plaintes des rameurs retentissaient dans le vallon lorsque des mouches à feu les assaillaient, fâchées d’être dérangées. Même si leur piqûre n’a pas de conséquence dangereuse, elle est cependant terriblement douloureuse.
À force d’entêtement, les conquistadors arrivèrent en vue de la cataracte.
— Approchez-vous de la rive, dépêchez-vous !
Les hommes ramèrent encore. Cette fois, le défi consistait à affronter le courant que créait la chute d’eau, et plusieurs minutes furent nécessaires pour qu’ils parviennent à aborder de telle sorte que le lieutenant puisse sauter de l’embarcation et escalader les rochers glissants. Montant un layon qui contournait l’écume en furie, il se retourna afin de regarder le tableau des pirogues qui se balançaient dans les remous. Ces hommes, bien que bourrus, étaient des braves. Son devoir était d’achever cette quête et les ramener à la prospérité ainsi qu’il s’y était engagé des années auparavant.
L’officier leur adressa un signe pour leur indiquer que tout allait bien, et suivit la fille qui venait de fuir en se faufilant sous la chute.
Sa première surprise fut de constater que l’eau masquait une énorme cavité. Elle était insoupçonnable, l’eau, la végétation et la disposition des rochers la rendaient invisible, même en se tenant au pied de la montagne. Immédiatement, il perçut qu’elle ne semblait pas façonnée par l’érosion. Le temps ne pouvait pas avoir sculpté des murs droits et continus comme il le détectait en passant la paume sur la roche. Il se glissa dans l’ouverture et déboucha dans une grande grotte sinistre. Le lieu ne pouvait être naturel. Si le plafond présentait des irrégularités et que des stalactites naissaient à nombreux endroits, certaines parois paraissaient exagérément bien alignées.
Il avança prudemment dans l’obscurité, et après quelques pas, faillit tomber en butant sur ce qui se révéla être des marches. Cette découverte le conforta dans la théorie que la main humaine ne soit pas étrangère à cet agencement. Mais il faisait de plus en plus sombre à mesure qu’il s’enfonçait dans la salle, et avant même d’en avoir atteint le fond, il ne voyait presque plus rien du décor qui l’entourait. L’idée d’avoir perdu la piste de la fille l’exaspérait, pourtant les ténèbres l’obligeaient à abandonner la poursuite et à rebrousser chemin.
L’espagnol revint vers l’entrée, agitant les bras et hurlant à l’intention de ses matelots pour tenter de dominer le grondement des eaux.
Dans l’attente, ses hommes s’étaient abrités de la chaleur montante. Certains, sous l’ombrage des arbres de la rive, somnolaient au fond des grosses pirogues, écoutant les bruits de ruissellement de la brume, le goutte-à-goutte, de feuille en feuille, et les cris d’animaux les berçaient. D’autres s’étaient approchés de la chute pour profiter de la fraîcheur qu’accordait la montagne, s’éclaboussant à grands coups de rames et riant comme des enfants. Quelques-uns se baignaient, observant le fond de la retenue pour guetter des poissons qui offriraient un dîner honorable à la troupe. Ils cessèrent leurs rêveries en découvrant les gesticulations de leur chef.
— Eh, les gars ! amenez des torches, des choses se cachent certainement là-dedans.
— Nous arrivons, lieutenant !
Ses compagnons s’activèrent pour accoster. La manœuvre se prolongea, car ils se virent contraints de sortir les pirogues de la rivière pour qu’elles ne se voient pas entraînées par le courant, occasionnant des efforts ponctués de plaintes et des jurons. Une fois les embarcations déposées sur les rochers, ils se dépêchèrent de rejoindre leur chef. Ils portaient des flambeaux emballés dans des toiles huilées avec la graisse des animaux qu’ils chassaient pour se nourrir. S’ils ne protégeaient pas le bois de cette façon, il se décomposait à une vitesse hallucinante, et les torches renfermaient tant d’eau qu’elles devenaient inutilisables.
Ils naviguaient en Amazonie depuis des années, accumulant les galères. La maladie faisait à présent partie de leur quotidien. Dévorés par les moustiques, plusieurs membres du groupe enduraient la malaria, quelques-uns en étaient morts, sans parler des serpents, des sangsues et des caïmans qui paraissaient les guetter dans les hautes herbes des rives. Toute la forêt semblait s’être liguée contre eux. Elle montrait qu’elle n’acceptait pas la présence de ces étrangers. C’était eux qui jouaient le rôle de parasites. Comme c’était eux les gêneurs, ce monde se défendait en leur envoyant ses cohortes de tueurs ailés.
En percevant l’excitation du lieutenant, la perspective de trouver enfin le trésor convoité réveilla leur motivation. Ils se pressèrent comme au premier jour, oubliant leurs souffrances pour quelques minutes. Il leur restait à affronter une épreuve : se frayer un chemin à travers d’énormes rochers et des arbres couchés. Le granit recouvert de mousse humide était glissant, les pieds dérapaient et certains gaillards, mieux taillés pour la lutte que pour l’escalade, chutèrent sur les pierres et se meurtrirent les genoux. L’ascension achevée, ils s’agglutinèrent auprès de l’officier pour entendre son récit.
Le lieutenant courait derrière cette fille depuis des mois, convaincu qu’elle voulait établir un contact ou le guider quelque part. Il avait compris qu’elle ne se cachait pas vraiment, du fait que les tribus de la forêt savent se rendre invisibles si elles le souhaitent. Elle réapparaissait, de lieu en lieu, l’entraînant vers le cœur de l’enfer vert. L’aventurier n’était pas innocent, il concevait que cette poursuite pouvait aussi le mener à un piège, mais son désir de voir aboutir la mission de sa vie le poussait à persévérer.
Lui Francisco d’Orenalla avait donné plus de la moitié de son existence à chercher l’Eldorado, sans succès. De fait, aucune piste ne devait être négligée et cette fille mystérieuse lui paraissait la plus sérieuse, d’autant qu’elle se révélait être certainement la dernière.
Sa troupe, étonnée à son tour de découvrir la grotte, s’entassait maintenant dans l’entrée de la galerie.
— Allumez les flambeaux, on y va !
La dizaine d’Espagnols se faufilèrent dans le passage bas et empruntèrent les marches. À présent, ils distinguaient la régularité des murs et d’autres ouvertures semblaient se dessiner au fond de la première salle. Le lieutenant ne cessait d’inciter ses hommes à la prudence, néanmoins l’impatience était palpable. Au détour d’un couloir, un colosse lança un flambeau pour scruter l’endroit avant de prendre le risque de s’y engager. Une paroi scintilla de mille feux devant lui. La torche renvoyait des milliers d’éclats vert et rouge sur le plafond rocheux.
Ce fut le signal de l’euphorie : tous se ruèrent dans les profondeurs de la grotte, ayant du mal à croire ce qui se présentait à eux. Le mur proposait des dizaines de niches, chacune remplie d’émeraudes et de diverses pierreries. Ils remarquèrent que le sol réfléchissait la lumière. En baissant les yeux, ils s’aperçurent qu’il était composé de pavés d’or soigneusement emboité les uns dans les autres pour constituer un chemin qui continuait au loin, comme s’il plongeait dans les entrailles de la Terre.
— De l’or, des diamants, des émeraudes et tant de trésors insoupçonnés ! Cette fois, vous l’avez trouvé, lieutenant : l’Eldorado…
— Je ne sais pas José… je ne puis dire. Pour être honnête, je m’attendais à une architecture plus sophistiquée. Nous avons beaucoup voyagé pour retrouver ce qui ne semblait qu’un mythe, et à de nombreuses occasions, nous avons découvert des temples inachevés ou tout bonnement des leurres censés nous égarer. Pourtant, ces structures inutiles étaient toujours agrémentées de statues ou de bas-reliefs sculptés de main de maître.
Ici, rien ne ressemble à cela, les bâtisseurs se sont limités à tailler des passages et des salles sobres. En revanche, nul ne peut nier que l’endroit paraît immensément étendu et que les trésors qu’il recèle sont d’une importance considérable par rapport à ceux accumulés depuis dix ans. De plus, je pensais découvrir quelques secrets de cette civilisation mystérieuse. Aucune fresque ou la moindre sculpture ne raconte leur histoire. Le roi sera sans doute ravi d’apprendre que nous rapportons une fortune colossale, mais de mon côté, je m’attendais à une ornementation plus folklorique, comme toutes celles que nous sommes parvenus à démasquer précédemment.
Mais laissons s’exprimer notre satisfaction, les hommes en ont besoin. De toutes les manières, je doute qu’à cet instant mon avis les intéresse.
Les décors qui se dévoilaient à mesure de leur progression plongeaient son esprit dans une confusion qu’il ne pouvait expliquer. Les richesses dissimulées dans les salles qui s’enchaînaient étaient bien réelles, peut être que la solution à ses préoccupations se révélait moins compliquée : un peuple avait imaginé que des intrus tels que lui chercheraient une ville bien établie comme celles découvertes en débarquant sur ce continent. Ils espéraient qu’il n’envisagerait pas que les bâtisseurs se contentent d’enterrer ces trésors afin de les conserver dans l’attente de temps meilleurs. L’hypothèse tenait la critique : les Européens avaient anéanti ces cultures et leurs croyances, et la crainte des actes sanguinaires de ces envahisseurs leur avait appris la prudence.
Les grandes civilisations de l’ouest avaient astucieusement accumulé les mythes et les réalités dont les peuples autochtones garnissaient leurs récits. À force de les raconter et de les enjoliver, ils avaient tissé une légende captivante à laquelle les morceaux de temple disséminés dans les recoins les plus improbables de la jungle donnaient un fondement.
Néanmoins, lui, Francisco De Orenalla, avait voué sa vie à démêler cet écheveau et venait de vaincre ce jeu de piste monumental. N’importe qui, comme ses hommes qu’il apercevait dans les lueurs des torches, aurait sauté de joie pour avoir enfin résolu cette énigme. Orenalla, à l’inverse, ressentait un vide abyssal monter en lui, et un épais ennui boucher son horizon.
Il se savait vieux à présent, et acceptait que ce voyage fût le dernier. Avec quoi allait-il remplir ses journées de patriarche richissime, à compter de cet instant ?
Il allait devoir apprendre à attendre la mort sans autre but que de la rendre la plus douce possible.
Heureusement, l’image de sa tendre épouse lui apparut et sa raison renoua avec le bon sens. La nostalgie parut reculer d’un coup face à ces nouveaux projets. Il pourrait relater ses aventures dans une œuvre aux côtés de sa femme bien-aimée.
Il reprit ses esprits et constata que la salle au milieu de laquelle il se tenait était dans un chaos total. Ses hommes se comportaient en véritables pillards, renversant tout sur leur passage. La lumière blafarde des torches achevait de désoler ce décor. Le lieutenant se ressaisit et décida de remettre de l’ordre dans ses rangs.
Ses compagnons avaient tellement hâte de localiser le ventre de ce temple, qu’ils couraient dans les galeries, dévalant des marches irrégulières qui parfois les entraînaient dans des chutes. De toute la profondeur de la montagne remontaient des cris indicateurs ou des rires qui notifiaient une découverte encore plus extraordinaire.
Le lieutenant et ses seconds, plus prudents, suivirent un conduit qui descendait en pente douce. Après plusieurs mètres, une lueur ténue apparut au bout du couloir. Ils arrivèrent dans une petite salle. La lumière tombait d’orifices au plafond. Des Indiens avaient percé la voûte pour faire entrer le soleil afin qu’il éclaire une sorte d’autel qui trônait au centre. Ce travail était pharaonique. Les hommes restèrent figés, stupéfaits par l’ingéniosité du labeur.
Ils subissaient l’emprise de la curiosité et cherchaient dans tous les recoins des grottes. Les rires des explorateurs ne cessaient de se répercuter dans les cavités. Les Espagnols se laissaient couler les pierreries sur la tête ou s’ajustaient des colliers d’or. Ils s’emplissaient les poches, le plus qu’ils le pouvaient. Quelques excités s’étaient même attaqués aux pavés du sol, essayant de les desseller avec leurs couteaux.
Ils continuèrent à sillonner l’immense dédale de couloirs, lorsqu’un grondement monta de l’épigastre de la montagne. Le tremblement fit tomber de la poussière des plafonds, certains murs semblèrent se fendre. La troupe avait trouvé différentes voies dans les recoins obscurs des salles, et ne songeait plus qu’à découvrir d’autres trésors. Certaines ouvertures paraissaient mener vers les abîmes de la terre. Les plus téméraires disparaissaient par des galeries sombres. L’officier, revenu sur ses pas, ne parvenait pas à freiner l’enthousiasme de son groupe et tentait de ramener les hommes à la raison en leur criant des ordres. Un joyeux bazar régnait, que les menaces montées des profondeurs n’arrivaient pas à tempérer.
— Il s’en cache encore par ici, venez voir, on dirait qu’un passage se poursuit sous la montagne.
— Halte ! calmez-vous et écoutez-moi maintenant ! Je crois que la sagesse nous dicte de faire demi-tour. Nous sommes imprudents, d’autant que nous ne sommes pas correctement préparés. Nous dresserons un campement au bord du lac et reprendrons les fouilles demain pour étudier les lieux avec discernement et un peu plus d’organisation. Cet endroit, si c’est bien lui, représente vingt ans de recherche, presque toute ma vie. Je pense que cela peut attendre une journée supplémentaire.
— Je suis d’accord ! rétorqua son second qui ne guettait qu’une telle excuse pour ressortir, car il se découvrait quelque peu claustrophobe.
La troupe fit contre mauvaise fortune, bon cœur, et s’engagea dans les tunnels qui les ramenaient à l’air libre.
L’homme qui ouvrait la marche du petit groupe, après une centaine de mètres, annonça :
— C’est bouché, mon lieutenant… par des rochers qui ne se trouvaient pas là lors de notre premier passage.
— Ça s’est écroulé, sans doute à cause des tremblements de tout à l’heure.
— T’es sûr ? Tu ne t’es pas trompé de trajet ? Tout le monde peut s’égarer dans ce dédale de couloirs.
— Non, non, j’avais marqué l’itinéraire. Je suis certain que c’est le bon chemin.
Un grondement monta à nouveau, faisant vibrer la grotte, puis s’éteint progressivement. Les hommes ne pouvaient plus masquer leur inquiétude : les bruits et les éboulements… Les plus anxieux commencèrent aussitôt à essayer de dégager les pierres, réprimandant ceux qui restaient immobiles.
Le lieutenant se tenait à l’écart. Il venait de comprendre que la vie qu’il avait dédié à découvrir les secrets de cet enfer vert allait se finir ici.
[1] Les Barbades
1541.
De grosses pirogues encadraient un brigandin et glissaient en silence sur les eaux du Napo, un affluent calme de l’Amazone. Le chef Omagua se tenait majestueusement debout à la proue du bateau de tête, guidant les pilotes sur ces eaux troublées qu’il connaissait par cœur. Il s’était paré de ses plus belles plumes et de colliers de graines multicolores afin que les tribus qui voyaient passer le convoi sachent que les envahisseurs dépendaient de ses compétences. Cet Inca pensait faire la fierté de son peuple.
La vérité sur cette alliance inattendue était bien moins reluisante : les conquistadors avaient débarqué sur la côte Atlantique depuis longtemps. Après avoir découvert les fascinantes villes aztèques, puis incas, et surtout les richesses de ces civilisations, ils s’emparèrent de leur or, et mirent à genoux ce qui deviendra les régions du Mexique jusqu’au Pérou. Les Espagnols laissèrent derrière eux des colons impitoyables. Ceux-là se chargeaient de s’approprier les territoires en vue de développer l’agriculture et d’extraire les minerais rares des sous-sols. Ils soumirent les populations à l’esclavage pour parvenir à leur fin, avec une cruauté inhumaine. Comme pour ces conquérants, un peuple qui n’épousait pas leur fervente religion était forcément dégénéré, ils se firent accompagner de missionnaires afin de ramener ces brebis égarées dans les rangs de Dieu. Les premiers à fouler la terre du Nouveau Monde furent les jésuites qui usèrent de méthodes abominables pour convaincre de pauvres hères à se convertir.
Ayant fini par mesurer les limites des ressources de ces régions, manquant de main-d’œuvre à force de punitions mortelles et de l’exode des populations, ils envoyèrent plusieurs expéditions de l’autre côté des Andes. C’est à cette occasion que les tortionnaires croisèrent la tribu Omagua, dont le chef, par souci de sauver son peuple, accepta de servir de guide aux Espagnols désireux de s’enfoncer dans ces contrées inconnues.
La rivière était parsemée de pièges changeants. À la saison sèche, des pierres et des troncs tombés dans les eaux affleuraient et éventraient les coques. Lorsque les pluies abondantes remontaient le niveau des cours d’eau, des courants naissaient et entrainaient les embarcations vers des chutes où elles terminaient leurs parcours sur les rochers. Seuls les autochtones pratiquant ses flots depuis leur enfance avaient la capacité de déceler les humeurs du fleuve.
Le chef, raide comme une statue, indiqua aux pilotes de dévier les bateaux vers la droite et de commencer à se préparer à accoster. À la sortie d’une courbe de la rivière, les marins découvrirent que quelques carbets se blottissaient dans un creux de la forêt.
Un soldat s’approcha du lieutenant pour lui traduire les propos de l’indien.
— Il explique que c’est un village d’Arawak et qu’ils sont pacifiques. Il conseille de passer la nuit ici, car nous aurions à affronter des chutes qui se trouvent un peu plus bas. Il assure que la raison dicte de braver cette épreuve à la levée du jour.
— Alors, débarquez et commencez à monter les tentes. Demandez aux cuisiniers de dresser l’inventaire des vivres dont disposent ces sauvages, répondit Francisco de Orellana à l’interprète.
Ses ordres donnés, Orenalla se dirigea vers l’arrière de l’embarcation. Un officier, reconnaissable par les plumes du casque qu’il portait malgré sa posture, se tenait là, effondré sur un siège de toile. Pâle comme la lune, il claque des dents en dépit de la chaleur moite de la jungle.
— Gonzalo, nous passerons la nuit dans cette tribu, voulez-vous que je consulte le chaman pour qu’il vous confectionne une concoction apaisante ? Ces Indiens savent calmer la malaria grâce à leur connaissance des plantes, car ces affections font partie de leur quotidien, admettez leur compétence. Je peux témoigner de l’efficacité de leur médecine pour l’avoir estimée moi-même.
— Plutôt mourir que de me laisser soigner par ces ensorceleurs. Ils profiteraient de ma faiblesse pour me faire avaler des poisons, soyez-en certains. En revanche, je fumerais bien une de ces sortes de cigares qui contiennent des substances, ça me soulage et m’aide à dormir !
— … Vous avez tort, capitaine… je vais néanmoins diligenter un gars afin qu’il en réclame au sorcier de ce village. Je débarque pour m’assurer du bon déroulement des négociations.
Francisco ne comprenait pas pourquoi le cadet de Pizarro n’envisageait pas que les Indiens puissent maîtriser la pharmacopée des maladies courantes de leur pays. Personnellement, il avait testé ces remèdes lorsqu’une flèche le toucha au visage au cours de la bataille de Quito. Sans des applications de plantes, la pointe qui l’avait atteint aurait certainement infecté la plaie, l’entrainant vers une mort lente et douloureuse. Il avait certes perdu un œil, mais aucune migraine ou souffrance prolongée n’avait affectées son travail, et une semaine après l’incident, on le découvrait de nouveau à cheval, qui s’employait à combattre les guerriers incas.
Le lieutenant Orellana avait rejoint Francisco Pizarro lors de sa troisième tentative d’asservissement de l’Amérique centrale. Ils étaient vaguement cousins par le jeu des mariages arrangés. Ce frère ainé d’une famille de petits nobles, un des premiers colonisateurs, se dévoila d’une cruauté sans égal. Il voulait prouver sa dévotion à la couronne, et ses premiers échecs ayant fourni des arguments à ses détracteurs, il se montrait d’autant plus revanchard. Celui-ci trahit les autochtones à plusieurs reprises, révélant, si besoin était, que les peuples ne pouvaient pas faire confiance à ces envahisseurs.
Il parsèmera l’histoire d’actes odieux, ne renonçant à aucune méthode répréhensible pour arriver à ses fins. Francisco De Orenalla, qui n’était pourtant pas tendre, s’offusqua des procédés de ce tortionnaire et demanda à accompagner Gonzalo, le frère cadet de Pizarro, dans une mission ordonnée par le sanguinaire.
Son travail consistait à repérer des routes pour de futures installations de possessions espagnoles. Des petits groupes d’explorateurs étaient partis en éclaireurs, plusieurs semaines auparavant, et leur silence inquiétait le chef suprême. Bien qu’il ne doutât jamais de la supériorité espagnole, il tenait à connaitre les avancées de la colonisation de l’est.
Si Gonzalo se révélait moins brutal que son ainé, il ne bénéficiait pas non plus d’un sens développé de la diplomatie. De fait, toutes les tribus rencontrées le long de leur périple finissaient par s’opposer aux conquistadors et se réfugiaient dans les montagnes ou les forêts pour s’organiser en guérillas. Déjà, lors de l’ascension de la cordillère pour rejoindre l’amazone, les soldats furent la cible de guet-apens imaginés par ces rebelles, et Gonzalo perdit énormément d’hommes dès le début de son expédition.
Des combattants moururent de froid au cours de la progression. Les estropiés, victimes des dernières attaques, ne pouvaient plus participer aux activités de la garnison, la situation s’aggravait encore avec le manque de vivres.
Francisco Pizarro.
L’espagnol, debout devant les grandes fenêtres, regardait l’écume des vagues qui s’écrasaient sur les falaises en contrebas. À cette période, il se trouve à Panama avec son armée, et s’informe de l’évolution d’un conflit entre deux Incas. Un sous-officier de la milice indienne, un groupe de déserteurs qui s’étaient ralliés aux Espagnols en sentant le vent tourner, se tenait non loin de lui. Le jeune truchement tremblait d’avoir contrarié Pizarro dont les éclats d’humeur étaient réputés violents.
— L’empereur attend de moi que je colonise le Pérou où s’opposent deux frères désireux de s’emparer du pouvoir après le décès du roi. J’ai débarqué avec une petite troupe et je suis parvenu cette fois à prendre le contrôle des populations. En plusieurs circonstances, je me suis vu acculé, et en fin stratège, j’ai sauvé la vie de mes soldats avec un talent indéniable. Et là, vous me conseillez de ne pas attaquer ces militaires d’opérettes ?
— C’est surtout qu’ils sont fort nombreux et que rien n’indique qu’ils ne soient pas capables de se réunifier, uniquement le temps de vous détruire.
— Dites-moi simplement comment tourne l’affrontement entre les deux Incas. L’aspect tactique, je m’en charge…
— La guerre civile paraît donner l’avantage à l’Inca Atahualpa. Cependant, le second frère s’est replié dans les montagnes et organise des embuscades sanglantes.
— Dans ce cas, envoyer un émissaire auprès de cet Atahualpa pour lui allouer une entrevue.
— Le pensez-vous vraiment, ce peuple est dangereux et nous exècre ?
— J’en suis conscient, sergent, voilà pourquoi vous ferez savoir aux Incas que cet entretien se déroulera sans arme.
Une quinzaine de jours plus tard, le jeune souverain entre dans Panama à la tête d’une centaine de guerriers.
— Bienvenue au Nouveau Monde, Votre Altesse ! le flatta Pizarro.
— Vous brûlez les étapes, mon ami. Pour le moment, je ne suis qu’un prince en guerre.
— Si je vous ai demandé de venir, c’est bien parce que vous paraissez malgré tout recevoir l’unanimité de votre peuple.
— Je semble, en effet, emporter l’adhésion de la majorité de la population.
— Voilà les raisons qui me font m’adresser à vous plutôt qu’à votre frère.
— Votre empire n’a pas brillé par sa diplomatie depuis son arrivée sur nos territoires. Votre perfidie est connue de toutes les provinces. Pourquoi ne pas m’indiquer franchement votre objectif ?
— Je désire en effet que votre peuple se soumette à la couronne espagnole. Si vous acceptez, je contribuerai à vous installer sur le trône. Nous vous soutiendrons et gouvernerons ensemble.
— Les Incas possèdent ces terres depuis la nuit des temps. Jamais nous ne laisserons quiconque dicter nos actes. Seuls les Dieux peuvent influencer nos décisions.
— Alors, vous m’obligez à l’obtenir par la force, ne serait-ce que pour vous prouver que vos Dieux ne valent pas grand-chose à côté du nôtre, répondit Pizarro en levant le bras.
Une dizaine de soldats jaillirent de derrière les tentures qui garnissaient la salle et entourèrent le roi inca.
— Vous êtes un traitre. Vous aviez promis que personne ne viendrait en arme.
— Eh oui ! Vous vous êtes montré assez stupide pour le croire… gardes, enchaînez-le !
— Mes guerriers ne vous laisseront pas faire. Ils sont plus de cent à patienter dehors.
— Et désarmés ! Allons achever cette négociation sans plus attendre.
L’esprit félon de l’espagnol avait tout prévu. Pizarro avait regroupé l’armada de Atahualpa dans la cour du palais qu’avaient investi les conquistadors. Ceux-ci les avaient invités à un banquet au cours duquel le vin coulait à flots. Les Incas découvraient cette boisson, ils l’appréciaient et en abusaient. Les soldats éméchés riaient et chahutaient sous l’emprise de l’alcool, inconscient du drame qui se tramait à leur insu.
Pizarro amena son prisonnier sur le perron qui dominait la place, puis s’adressa aux Incas :
— Guerriers ! Je détiens votre roi en otage. Reconnaissez que vous admettez la couronne d’Espagne comme seule autorité et vous sauverez sa vie et les vôtres.
La stupeur saisit des Incas enivrés qui comprirent le piège et voulurent empoigner leurs armes. Ils réalisèrent qu’on les leur avait retirés en entrant. Certains se levèrent en titubant pour tenter d’attaquer Pizarro. Une fois encore, les soldats espagnols qui se tenaient cachés jusque-là surgirent et commencèrent à tirer sur la troupe.
La confusion fut totale. Les Incas couraient en tous sens, essayant de se protéger des mousquets. Lorsque de petits canons prirent le relais, la cour se vit bientôt jonchée de corps.
Les conquistadors achevèrent les blessés à grands coups d’épées et regroupèrent les rares survivants.
— Incas ! À présent, rentrez chez vous pour annoncer à votre peuple que je retiens leur Roi. Puis, se tournant vers la fontaine qui ornait le patio :
— Regardez attentivement ce bassin, il sera libéré si vous me livrez assez de trésors pour le remplir entièrement.
Plusieurs semaines passèrent avant que les Incas reviennent avec six tonnes d’or.
Atahualpa s’adressa ainsi à l’espagnol :
— Voilà ! Nous avons répondu à ta demande. Rends-moi la liberté.
— Me considères-tu comme assez stupide pour te laisser repartir ? Tu reformerais aussitôt ton armée pour m’assiéger. En plus, je t’estime tout à fait capable de me vaincre.
— Mais tu avais promis ! Tu contreviens à ta parole ? Ta race ne saurait-elle que mentir ?
L’effroi courait dans les rangs des Incas qui avaient livré la rançon et des guerriers s’étaient déjà emparés de leurs lances. Un des chefs rétablit le calme et s’avança vers Pizarro.
— Nous n’aurons de cesse de délivrer notre Roi. Nous te traquerons jusqu’à ce que ton sang s’écoule dans les rigoles de la pyramide de Machu Picchu.
— En ce cas, évitons les massacres inutiles… en tant que représentant de l’empereur, je condamne à mort l’Inca Atahualpa !
Et avant que quiconque ne puisse réagir, Pizarro sortit son épée et éventra le jeune prince.
— Voilà qui boucle cette affaire ! Allez dire aux peuples qu’ils subiront le même sort s’ils n’adhèrent pas à l’Espagne.
Francisco Pizarro, en multipliant ces démonstrations de cruauté, acheva d’envahir le Pérou et entra dans Cuzco. C’était la ville où se dressait le légendaire temple du soleil. Il mettra à sac cette cité, où il érigera l’église de Santo Domingo sur les fondations de granite qui étaient jadis celles du célèbre sanctuaire.
C’est à cette époque que Pizarro, autoproclamé consul, décida de confier une mission à son frère, Gonzalo.
— À présent, notre autorité est reconnue dans cette partie du Nouveau Monde. Toutefois, les peuples de ce pays ont considérablement épuisé les ressources de leurs terres. Nous devons aller chercher plus loin. La cannelle fait la fortune de nos fermiers, mais cette région en manque. Des guides indiens prétendent connaitre des endroits où les canneliers poussent comme de mauvaises herbes sur l’avers des montagnes.
— Que désires-tu, mon frère ?
— Tu vas prendre une garnison et aller explorer le versant Est de la cordillère. On m’a rapporté que les trésors sortaient du sol sans effort et qu’une ville en or dégorgeait de richesse. Nous devons être les premiers à le localiser. Des colons sont déjà partis démarcher dans ces contrées, et établissent des paroisses. Ils vous fourniront le soutien logistique nécessaire à vos prospections.
De l’autre côté des montagnes, pas de cité, à peine de villages, et surtout pas de canneliers. Gonzalo entra dans une telle colère en découvrant ce mensonge, qu’il fit dévorer les guides indiens par ses chiens. Il ne trouva qu’une multitude de petites tribus. Elles sont nombreuses, parfois radicalement différentes : certaines assez sédentaires, d’autres nomades. Les clans les plus proches de la cordillère, influencés par la culture inca, sont de farouches guerriers et provoquent les Espagnols sans complexes. Une peuplade d’hommes, qui vivent nus, les pourchassera sur le fleuve durant des semaines. Pourtant, plus l’expédition descendait l’Amazone, plus les populations se montraient pacifiques.
Dans leur globalité, toutes vivent en harmonie avec la nature, retirant de la forêt et des rivières justes le nécessaire pour subsister. Lorsqu’une région s’épuise, ils repartent plus loin pour reformer un village de carbets, ces grands abris aux toits de palme dépourvus de murs. Des critères que les Espagnols se trouvent incapables de comprendre, empêtrés dans leur rigueur militaire.
Cependant, les habitants du Pérou inventèrent un mythe pour se débarrasser des envahisseurs. Depuis qu’ils avaient posé le pied sur le continent, les conquistadors entendaient la légende d’une ville en or. Face aux richesses qu’ils avaient découvertes dans leurs conquêtes récentes, ces explorateurs étaient disposés à gober n’importe quelle histoire locale.
De nombreuses expéditions fouillèrent les forêts à la recherche de la cité secrète. Peu en revinrent, pourtant, tous distribuèrent la mort sur leur passage, autant par les armes que par les maladies. Ces exactions finirent d’attiser la haine des peuples envers ces soldats assoiffés de sang, accompagnés de missionnaires Franciscains désireux de les convertir de force.
Pour le moment, la préoccupation du lieutenant Francisco D’Orellana restait l’état de la troupe. Gonzalo Pizarro, sous l’emprise de la malaria, se trouvait incapable de diriger les combattants correctement. Des tribus belliqueuses qui leur avaient dressé des embuscades dans la cordillère étaient parvenues à tuer des hommes et les peuplades rencontrées sur le fleuve refusaient de plus en plus fréquemment de leur fournir des vivres.
Il remonta son col, le froid des montagnes descendait jusqu’ici et annonçait l’hiver. Les maisons du village s’élevaient devant lui, rectangulaires, couvertes de toits de palme, sans murs sur les côtés. Une plateforme rehaussée sert à protéger les habitants des crues saisonnières et des bêtes sauvages.
Apercevant leur guide en pleins palabres avec un Indien, le lieutenant entreprit de les rejoindre pour s’assurer que les négociations avancent. Il a commencé la création d’un lexique en quechua qui lui permet de communiquer péniblement avec les autochtones. En s’aidant de mimes et de dessins tracés sur la terre, il interrogea l’indien :
— Possèdent-ils suffisamment de ravitaillement à fournir pour nourrir la troupe ?
— Pas assez. J’ai sollicité le chef afin qu’il envoie les habitants pêcher dans la rivière pour améliorer l’ordinaire. Dommage que vos soldats n’exploitent pas les connaissances des Indiens. Assimiler leurs méthodes serait judicieux pour la suite du voyage. Cet art pourrait servir à vos compagnons. Arrivés au grand fleuve, les flots sont généreux si l’on apprend à les amadouer.
Au matin, Orenalla constata l’absence du chef Omagua. Celui-ci avait disposé de la nuit pour se sauver. Il descendit vers la rivière pour découvrir qu’une pirogue avait disparu, et alla l’annoncer à Pizarro.
Le capitaine espagnol claquait toujours des dents lorsqu’il invita Orenalla à entrer dans le carbet où il s’était réfugié.
— Gonzalo, le guide a profité de l’obscurité pour s’enfuir en volant une embarcation.
L’officier se leva en grimaçant, l’affection provoquait des douleurs et des courbatures musculaires éprouvantes. D’une voix fatiguée, il répondit :
— Arrêtons ce cirque. Tu vas demander aux taquiers[1] de construire un bateau pour transporter les malades et les blessés jusqu’à la première ville. Je les accompagnerai aux fins de recevoir des soins de nos médecins. Toi, je te laisse soixante hommes afin que tu descendes le fleuve et regroupe des vivres plus bas. Je te rejoindrais ensuite avec des troupes fraiches.
— Pourquoi présumes-tu que de la nourriture nous attendrait plus loin ?
— Nous avions envoyé des colons en éclaireurs, il y a quelque temps. Ils ont informé mon frère que le climat est favorable là-bas. La pêche ainsi que la chasse sont prospères dans les régions de l’Est, ils pourront fournir le nécessaire au bon déroulement de notre expédition.
Orenalla longea alors le cours du Napo avec une petite garnison de gars robustes. Le seul fait d’avoir réchappé à tous les incidents du voyage prouvait leur rudesse. Les courants portaient les navires, n’exigeant pas d’effort aux membres de l’équipage. Le froid de la montagne s’atténua à mesure qu’ils s’éloignaient, le moral de la troupe s’améliora en même temps que la température remontait. Ils ignoraient qu’ils se dirigeaient vers la moiteur de la forêt profonde et ses milliers d’insectes agressifs.
Parfois, ils devaient contourner des sauts. L’imposante taille et le poids des embarcations espagnoles étaient un handicap dans ces manœuvres. Les hommes devenaient attentifs lorsque les ondes se mettaient à bouillonner. La vue du rapide faisait courir un frisson d’inquiétude sur les batelets. Le bruit de la confusion entre l’eau et les rochers montait en intensité au fur et à mesure qu’ils approchaient. Les pilotes, aidés de costauds équipés de perches de bambous, parvenaient à orienter les bateaux vers les bras d’eau dissimulés sous les feuillages, moins violents. Souvent, le petit cours d’eau est étroit, garni d’innombrables racines et de troncs tombés là. Si les pirogues des éclaireurs se faufilent sans problème dans ces méandres, les bateaux à fonds plats sont trop gros pour s’accommoder du peu de tirants d’eau.
Orenalla s’inquiète à chaque occasion d’entendre la coque taper sur les rochers. La végétation intense oblige les hommes à rester courbés en continuant à guetter les obstacles et tâcher de les contourner à grands coups de bâtons. Mais, au-dessus de leurs têtes, les branches peuvent aussi cacher de redoutables anacondas, des fauves, des serpents ou des insectes aux piqures douloureuses qui aiment se laisser choir sur leurs proies lorsqu’ils sont dérangés.
De longues minutes après s’être glissé dans ces goulots, ils ressortent des feuillages et retrouvent le cours principal. Le grondement sourd du saut se fait encore entendre derrière eux lorsque l’écho de la vallée renvoie les cris de victoire des équipages.
Ils rejoindront bientôt l’Amazone, cherchant des traces de vie sur les rives du puissant fleuve. À force de persévérance, alors que les explorateurs commençaient à ne plus y croire, les éclaireurs revinrent vers le bateau d’Orenalla pour l’informer de leurs dernières découvertes.
— Lieutenant, nous avons repéré des vestiges d’un campement important, plus loin. Des cadavres jonchent la clairière, certains empalés sur des pieux. L’essentiel du matériel a brûlé.
— Certainement des Incas fuyant les sévices de Pizarro se sont-ils vengés sur ces malheureux. Cette fois, nous sommes fixés : nous sommes seuls. Ce n’est pas vraiment une surprise, l’optimisme de Gonzalo n’était pas justifié. Nous aurions eu la confirmation de leur bonne installation si cela avait été le cas.
L’officier décida de faire accoster les embarcations, regroupa la troupe afin de leur tenir ces propos :
— Soldats ! Je crains que Gonzalo diminué par ses fièvres, nous ai envoyés dans cette région sans raison. Nous ne trouverons pas plus de vivres en ces lieux qu’ailleurs. Continuons à descendre le fleuve et cherchons de la nourriture et de l’or plutôt que de guetter le retour de Pizarro… si seulement il nous rejoint un jour, chose improbable à la vue de son état lorsque nous l’avons quitté. Si nous attendons ici, la mort viendra, ou par la faim, ou par les attaques des tribus locales. Ils ont l’avantage du terrain.
Un grand murmure courut dans les rangs des aventuriers. Ils s’interrogeaient sur les répercussions de cette décision, pesant le pour et le contre. Finalement, un de ses seconds prit la parole :
— Lieutenant, nous sommes une majorité à penser que Pizarro et ses hommes ne reviendront vraisemblablement pas. Tant bien même le ferait-ils, que cela risque d’arriver dans plusieurs semaines. Nous proposons de vous suivre dans votre quête du minerai précieux si nous répartissons les bénéfices en parts égales.
— Mes amis, croyez bien que l’or m’intéresse peu. Je veux trouver l’Eldorado avant tout. Les richesses que nous découvrirons seront partagées en parts équitables, toutefois nous en conserverons une partie pour la couronne, afin d’expliquer que les raisons profondes de notre trahison étaient bien de servir le roi. N’omettez pas ce détail : si la famille Pizarro survivait aux fièvres et à leurs abominations, des émissaires s’empresseraient de prétendre que nous avons fui sans porter assistance aux troupes. La colère qui emplira le consul à l’annonce de notre abandon le conduira peut-être à décider de déléguer une mission pour nous poursuivre. Je côtoie Pizarro depuis assez longtemps pour supposer que très bientôt, aux yeux de la couronne, nous serons soupçonnés de désertion, et qu’on nous attribuera même des actions que nous n’aurons pas commises. Le seul espoir de pardon qui demeure réside dans le fait que nombre d’officiers sont choqués des méthodes de ce petit roi, et ne manqueront pas de l’ébruiter lorsqu’ils rentreront en Espagne. Enfin, notre royaume dépense énormément d’argent dans les guerres et les expéditions pour découvrir de nouvelles terres. La simple vue d’une fortune peut effacer les reproches à notre égard.
Après trente minutes de conversations animées, une quarantaine d’hommes remontèrent sur les embarcations. Quelques bougres, craignant de passer pour des mutins, furent purement et tout bonnement abandonnés sur place. Leurs camarades leur laissèrent néanmoins trois mousquets et de la poudre afin qu’ils puissent chasser et se défendre.
Francisco Orenalla avait réussi, il pouvait à présent consacrer l’intégralité de son temps à la recherche de la mystérieuse cité d’or. Les propos qu’il venait de tenir à sa troupe n’avaient pas seulement pour but de les inciter à le suivre, il était persuadé du bien-fondé de son discours. Il était tout aussi convaincu que les exactions de Pizarro finiraient par contrarier la couronne. Les conseillers royaux n’étaient pas opposés à la violence contre les indigènes, mais avaient conscience qu’une fois l’autorité installée, une coopération avec les peuples permettait d’en tirer des profits maximums. De son idée, le bourreau sera rappelé à l’ordre d’ici peu. Lui-même avait réclamé à des hommes qui rentraient au pays de diffuser la rumeur. Restait à espérer que le pouvoir ne mettrait pas trop de temps à réagir.
Cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête ne lui offrait pas la possibilité d’échouer dans sa quête. Si la majorité des soldats bourrus n’étaient pas tous pourvus d’assez de finesse pour lire entre les lignes, les regards inquiets de ses seconds lui firent comprendre qu’ils étaient au fait de l’impasse dans laquelle ils venaient de s’engouffrer.
Anne.
Les fuyards avaient enduré deux saisons des pluies depuis le début de leur périple. Ils avaient descendu les deux tiers du grand fleuve et les aléas de l’aventure leur avaient appris à négocier avec les Indiens rencontrés. Dans l’ensemble, les tribus se montraient pacifiques sans pour autant accepter de commercer avec les envahisseurs. Ils se virent parfois obligés de prendre des villages de force pour trouver de quoi se nourrir. Cette exigence ne ravissait pas Orenalla. Il avait compris que les Indiens parvenaient à descendre des dizaines de lieues à des vitesses incroyables grâce aux courants et à leurs pirogues profilés comme des aiguilles. Cette rapidité leur donnait une telle avance sur leur lourd brigantin, que lorsqu’ils atteignaient les villages suivants, ils les découvraient déserts ou subissaient des attaques, ayant été avertis de leur venue.
Or, les Indiens restaient envoûtés par les plastrons et les tissus que revêtaient les conquistadors, eux qui ne portaient que des pagnes tramés avec des lianes. La mollesse de l’or n’autorise qu’à en tirer des parures. Alors, à l’occasion d’une étape dans un village, Orenalla profita de la fascination du chef du clan pour le métal pour troquer quelques pirogues et des vivres pour un mois contre deux plastrons rouillés et l’un de ses manteaux. Cette dépendance envers les tribus désespérait le lieutenant. Il avait insisté mille fois pour que la troupe s’enrichisse des techniques de pêche et de chasse des autochtones. À part les marins, qui avaient connu le besoin de subvenir à leur faim au cours de leurs longs voyages, les hommes d’armes, eux, ne voulaient pas quitter leurs uniformes élimés et trouvaient plus simple de dévaliser les populations en chemin.
Désemparé par ces constatations, Orenalla fut traversé par une idée qu’il jugea géniale et demanda aussitôt à s’entretenir avec les autorités du village. Il pensait pouvoir tirer profit de l’effet qu’il inspirait à cette peuplade. Son lexique quechua s’était enrichi, lui permettant de communiquer sans renfort de dessins et de mimes plus ou moins ridicules qui amusaient souvent ses interlocuteurs. Il s’assit face aux sages installés en cercle sous le grand carbet commun.
— Je sais que vous craignez nos armes et que nos équipements de protection qui brillent au soleil vous impressionnent. Et vous avez raison, car nous tirons nos pouvoirs de l’astre flamboyant. Faites-le connaitre sur tout le fleuve si vous souhaitez que vos frères ne s’exposent pas à notre courroux et je vous offrirais d’autres tissus avant de reprendre ma route.
Si, sans nul doute, les villageois ne s’inquiétaient pas de ce qui pourrait arriver aux tribus des rives en amont, l’idée d’obtenir davantage de ces vêtements fit son effet. Dans les semaines qui suivirent, ils furent accueillis comme des dieux et n’eurent nul besoin de menacer les sauvages pour récolter de quoi s’alimenter.
Au fur et à mesure de leur progression, la nouvelle s’éteignait et les conflits renaissaient.
En ce début de soirée, les pirogues qu’Orenalla avait dédiées aux éclaireurs remontèrent le courant vers le brigantin. José, l’un des fidèles seconds du lieutenant, vint se positionner contre le bateau et annonça :
— Mon lieutenant, j’ai découvert une clairière un peu plus bas. Ne pourrions-nous pas en profiter pour débarquer et passer la nuit au sec ?
— Pas de problème José, tu as raison. Je commence vraiment à en avoir marre de me faire piquer par les milliers de moustiques qui peuplent ce maudit pays. Nous allons dresser le camp et pourrons allumer un feu humide pour les éloigner. Ce n’est pas très efficace, mais ils nous ficheront la paix, au moins le temps que le jour décline.
À chaque crépuscule, des nuées d’insectes harcèlent tout ce qui se présente sur leur chemin. Les moucherons yen-yen sont terribles, parvenant même à sévir au travers des vêtements. Les attaques se calment un peu une fois la nuit tombée si l’environnement n’est pas trop moite. Hélas ! comme les explorateurs passent l’essentiel de leurs journées sur le fleuve, les eaux stagnantes des berges les exposent aux bestioles sanguinaires en permanence. Plusieurs étaient déjà morts de la malaria, contractée à force de piqures, à moins que ce ne soit à cause des scorpions, des serpents ou des caïmans qu’ils trouvèrent sur leur chemin.
Comme beaucoup d’animaux, ainsi que grand nombre d’Indiens de ces contrées, la bonne solution était de se couvrir de boue en la récoltant sur les rives. En séchant, la croûte rouge que formait la latérite bloquait les dards de la plupart des insectes volants. Les Européens refusaient ces méthodes de sauvages, arborant crânement les uniformes de l’armée espagnole sans vouloir y renoncer, bien qu’il n’en reste plus guère que des guenilles après ces mois de voyage.
— Allez, portons-nous à tribord les gars ! indiqua le second du lieutenant. Et en douceur. Vérifiez que des caïmans ne soient pas tapis dans les herbes avant de descendre. Alvaro, passe devant avec tes hommes pour ouvrir la voie, et sonde les bords.
Les embarcations dévièrent de leurs trajectoires pour s’approcher de la berge en glissant dans la mangrove. Alberto, un grand gaillard chargé de préparer l’accostage de la pirogue de tête, était penché au-dessus du bastingage, tapant les herbes avec sa perche de bambou, prêt à sauter dans l’eau au moment où il aurait pied. Il examinait les rives, ne voulant pas risquer de marcher sur un reptile qui se chaufferait au soleil. Dans les mangroves, les rameurs avaient été attaqués plusieurs fois par des serpents géants. Non point qu’ils souhaitent faire du mal aux humains, mais ceux-ci les dérangent dans leur pêche. Le serpent se love sur les branches basses afin de se laisser tomber alors qu’une proie se hasarde sous son observatoire. Son poids et ses anneaux puissants suffisent à assommer la victime dans un premier temps, pour l’étouffer ensuite. D’autres s’étaient fait mordre le pied ou les chevilles par des caïmans qui somnolaient sur les rives. Seuls les caïmans noirs, absents de ce coin, pouvaient tuer un homme. Restait que les plaies, aussi minimes soient-elles, s’infectaient à grande vitesse dans cette atmosphère. Les légendes jouaient leurs rôles également, et les aventuriers préféraient abuser de précautions.
Brusquement, Alberto se tapa sur le cou en ressentant une piqure. Il pensa que ce moustique-là devait être énorme, ou que c’était une mouche à feu, car la douleur se montrait plus vive qu’à l’habitude. Il râla en se frottant la nuque. Lorsque, les secondes suivantes, il tomba, raide mort, imité de près par un autre, Orenalla hurla :
— Les Indiens nous attaquent, mettez-vous à l’abri !
— Ça vient de l’arrière, abritez-vous.
Ils avaient déjà subi maints accrochages avec les petits hommes de la forêt et savaient que leurs flèches empoisonnées étaient redoutables. Après de nombreuses pertes, ils avaient confectionné des pavois de bois pour se protéger.
— Chargez vos armes et attendez mes ordres.
Un silence pesant s’installa, les embarcations continuaient de glisser vers le bord. Personne n’osait bouger dans les esquifs, scrutant les alentours pour déceler l’ennemi tapi dans les fourrés. Les marins, cachés sous leurs boucliers, guidaient les bateaux comme il le pouvait afin qu’elles aillent s’échouer sur la rive. La pirogue de tête heurta bientôt la terre rouge. Des hommes en descendirent tout en restant prudemment accroupis sous leurs protections. Ils se disposèrent de façon à couvrir l’accostage des suivants. Les derniers débarqués des embarcations eurent à peine le temps de se jeter derrière les abris que des flèches vinrent se ficher dans le sable et les pirogues proches d’eux.
— Guettez la forêt, n’hésitez pas à tirer au moindre mouvement.
Le groupe de tête fit feu à l’aveuglette en direction des arbres, convaincu que le bruit des détonations suffirait à faire fuir les attaquants. Ils furent obligés de rester dissimulés derrière leurs protections pendant de longues minutes. Les insectes utilisèrent cette immobilité pour les agresser sans ripostes probables. Un des soldats affutés à ces embuscades finit par crier :
— C’est bon chef, l’alerte est passée, semble-t-il.
Impossible d’apercevoir ces Amérindiens lorsqu’ils se cachaient dans la verdure, ils l’avaient appris à leur détriment. Seuls quelques oiseaux paraissaient se moquer d’eux. La tension s’estompa progressivement et chacun s’appliqua à l’ouvrage en fonction de son rôle. Orenalla se montrait fort contrarié d’avoir encore perdu des hommes et craignait toujours que cela agisse négativement sur le moral de la troupe. Il aimerait ne plus tarder à trouver de l’or pour calmer la lassitude qui gagnait les rangs.
— Allez, trois hommes patrouillent aux alentours, mettez cette excursion à profit en essayant de débusquer du gibier. Deux autres qui inspectent les abords du camp. Ceux qui restent, vous allumez le feu… enterrez également les morts avant qu’ils ne commencent à pourrir et à attirer les mouches. Nous leur rendrons les honneurs par la suite, lorsque nous serons mieux établis.
Ces hommes reproduisaient les mêmes gestes, chaque soir, au fil de la rivière, alors le campement fut aménagé en vingt minutes. De toute façon, désigner leur installation comme un village de tentes était prétentieux. Il n’était plus composé que de toiles misérables pour l’essentiel, usé jusqu’à la corde et raccommodé avec des palmes. Le plus important pour eux, était de se protéger des pluies diluviennes et la végétation proposait des feuillages suffisant à assurer ce rôle. L’ombre de la forêt masquait trop souvent le soleil et rien, ni les vêtements ni les équipements n’avaient le temps de sécher correctement. La moisissure détruisait les tissus et rouillait les armes à une vitesse vertigineuse.
L’abri du chef offrait plus de confort : une table et un tabouret pour pouvoir rédiger de nouvelles informations sur les cartes. Un lit bricolé avec des morceaux de bambous, assemblé avec des restes de bâches par des bouts de cordage achevait le mobilier.
Ils démarrèrent un feu humide afin de produire de la fumée protectrice. La troupe put oublier un moment les insectes et nettoyer superficiellement leurs chemises crasseuses. Les plus reposés avaient déjà taillé des branches aux fins de confectionner des javelots et surveillaient les flots pour empaler des poissons. Les gestes n’étaient pas encore assurés, toutefois, à force d’observer les Indiens, cette technique de pêche commençait à donner des résultats. Les rivières sont tellement poissonneuses que même les moins habiles ramenaient de quoi nourrir la troupe. Au moins, les Espagnols mangeaient à leur faim depuis qu’ils avaient accepté de subvenir à leurs besoins eux-mêmes. La chasse se révélait plus complexe. L’abondance de végétation stoppait les balles des mousquets, et bien souvent les animaux abattus étaient inconsommables. La seule bonne chose qui découlait de ces mésaventures, c’est que les belligérants admettaient progressivement qu’ils devaient enrichir leur expérience en côtoyant les sauvages.
Les soldats partis en reconnaissance revinrent à la hâte pour avertir :
— Lieutenant, un village d’Indiens occupe une clairière à quelques minutes d’ici, annonça l’un des éclaireurs.
— Ce sont certainement ces chiens qui nous ont attaqués tout à l’heure. Continuez de les surveiller, nous leur rendrons une petite visite ce soir. Apprenons à ces indigènes à considérer les représentants du roi d’Espagne comme leurs nouveaux princes. Par respect pour leur sacrifice, nous vengerons ainsi la mort de nos braves.
— Ces sauvages n’ont pas l’air bien nombreux, le problème sera vite réglé. Affirma un des éclaireurs.
— Alors, tant mieux. Rêvons que cette malencontreuse aventure permettra de récupérer des vivres pour la suite de notre descente. Pour le moment, détendez-vous et mangez quelque chose en attendant.
Deux heures plus tard, la bande s’étant reposée, Francisco décida que le temps de l’action était venu. Il expliqua son plan à ses hommes. Il donna un rôle à chacun pour que l’attaque de la tribu se déroule favorablement. La troupe ne connaissait pas le nombre d’âmes qui composait ce village, et bien que ceux-ci craignent les blancs, il préférait demeurer prudent.
Ces tribus pouvaient être, selon les régions, des guerriers redoutables qui ne renonçaient pas tant que leur restait une once de vie. La force des conquistadors ne tenait que sur le fait que les Amérindiens découvraient les fusils auxquels ils prêtaient une fonction divine. En revanche, les Espagnols devaient économiser la poudre qui se raréfiait, elle aussi détériorée par l’humidité. De plus en plus souvent, les mousquets faisaient non-feu, à cause de la poudre mouillée.
— Bien ! Toi, Pablo, tu prends six gars et tâches de barrer les accès à la forêt à l’arrière du village. Les chemins qui mènent aux espaces de culture leur servent de voies de repli la plupart du temps. Faites des brasiers pour éclairer la zone avant que nous attaquions.
— D’accord lieutenant, nous y allons.
— Diégo, tu t’occupes du flanc droit et tu essaies d’attraper des enfants. Si l’on capture des gosses, les adultes se rendront sans discuter. Nous en torturerons un ou deux si nécessaire, pour qu’ils braillent et attendrissent les autres.
L’officier établissait un plan d’action, sans grande conviction. Il présageait à trouver le village désert lorsque sa troupe arriverait. Si les Espagnols les avaient surveillés, probablement que les Indiens en avaient fait de même. Ils grimpaient dans les arbres aussi aisément que les singes, tirant des fléchettes empoisonnées aux alentours. Les mousquets, tant redoutés par les autochtones, bénéficiaient d’une précision toute relative, ne permettant pas d’atteindre des guerriers réfugiés dans la canopée. Il les imaginait, à cet instant, tapis dans les fourrés et les arbres autour du campement. Peut-être qu’ils écoutaient ses propos à cette minute. Certains Indiens avaient eu des contacts avec les religieux venus les évangéliser et maitrisaient les rudiments de leurs langues. En réalité, il ne croyait guère au succès de l’effet de surprise. Il ne jugeait pas non plus utile de décourager ses gars en leur confiant ses doutes avant même d’avoir entamé l’attaque.
— Faites attention tout de même, certains de ces sauvages ont déjà eu affaire à nous et ne nous redoutent plus autant qu’au début. Ils se méfient de nos mousquets, mais ne craignent plus les détonations qu’ils assimilaient au tonnerre. Ils ont pris conscience que nous ne sommes que des hommes et peuvent vouloir se défendre. Ils maitrisent totalement la connaissance du terrain. Ne vous aventurez pas à les poursuivre dans les sous-bois. Que ceux qui possèdent encore des vestes les portent malgré la chaleur. Le tissu épais suffit à stopper les fléchettes au curare si le tir vient de loin. Protéger votre cou autant que possible, ils aiment viser cette partie du corps, car le poison se diffuse rapidement à cet endroit.
On était loin des pyramides aztèques ou des palais incas installés dans des villes bien ordonnées. Les Indiens de la jungle, très mobiles, attaquaient et disparaissaient en fonction de l’évolution du combat. Cette méthode perturbait les Espagnols. Les conquistadors, rompus aux guerres traditionnelles, rencontraient des difficultés à s’adapter à ce type de guérillas. Heureusement, les tribus se composaient généralement de peu d’hommes, et le rapport de force donnait l’avantage aux envahisseurs.
#
Hototo, comme à son habitude, était assis en tailleur sous le grand carbet pour observer la vie du village. Un groupe de guerriers l’avait rejoint et s’était installé en cercle autour de lui pour lui demander son avis. Le vieil homme n’est pas le chef des Wayana, les tribus amazoniennes n’en ont pas généralement, et décident tout de concert.
Mais Hototo avait été un remarquable chasseur dans sa jeunesse, tuant plusieurs jaguars. Pour ces peuples, le fauve représente le prédateur suprême, symbole de force et cruauté. L’animal se retrouvait dans un grand nombre de leurs mythes et de leurs croyances païennes. Ces faits de bravoure lui accordaient implicitement le droit de statuer, en plus de la sagesse qui découlait de son âge.
— Si les Wiaipi ont attaqué les blancs comme vous me le racontez, ces derniers vont fatalement vouloir se venger. Personne n’admettrait que cette agression ne vienne pas de nous. L’offensive s’est déroulée à deux pas de notre village. Nous devons nous échapper dans la forêt pour mettre les plus faibles à l’abri. Ces hommes ne connaissent pas la pitié, qui plus est s’ils croient ne faire que se défendre. La tribu Wiaipi est vraiment la plaie de cette contrée, ne nous amenant que la mort depuis qu’ils ont fui le pied des montagnes. À présumer que les esprits nous ont abandonnés de nouveau.
— Hototo, nous n’allons tout de même pas nous laisser faire par ces envahisseurs, c’est de la lâcheté. Nous avons fait en sorte que les tribus ennemies acceptent la paix, au prix d’une guerre longue et éprouvante. Pourquoi ne pas réussir à en faire de même avec ces étrangers ?
— Bien sûr, si tu es pressé de rejoindre tes valeureux ancêtres dans la canopée, pars affronter ces hommes de fer. Tu pourrais aussi comprendre que c’est juste de la prudence. Leurs armes sont trop fortes pour nous. Peux-tu me citer les succès de nos peuples contre ces individus ? Même les puissants Incas de l’ouest ont été vaincus et réduits à l’esclavage. Les chamans venus par le fleuve ne cessent de ressasser les tortures et les viols auxquels ont été soumis les peuples de la montagne. C’étaient pourtant des guerriers redoutables. Ma sagesse n’est pas de la couardise. Nul n’affronte le jaguar à main nue s’il peut fuir auparavant. Gardez la raison.
Hototo savait se montrer persuasif, d’autant que c’était grâce à lui, à sa connaissance de la forêt, et aussi à son sens de la diplomatie qu’il avait mené les Wayana à la victoire contre les combattants descendus de la cordillère. Ainsi son peuple avait-il vécu sereinement depuis, même si cette paix semblait s’achever aujourd’hui.
Ils décidèrent donc de mettre les mères et les enfants à l’abri en les entrainant profondément dans la forêt, là où de petits cours d’eau leur permettraient de se procurer de quoi survivre si les hommes devaient ne pas revenir les chercher. Les plus jeunes se pliaient aux jugements des anciens, sans pour autant renoncer à l’affrontement, si les Espagnols s’entêtaient en les poursuivant. Les pièges destinés aux fauves qui parsèment les abords du village pouvaient se montrer efficaces contre des soldats alourdis par leurs équipements.
Une grande femme blanche était demeurée à l’écart depuis le début de la concertation. Elle respectait les coutumes, consciente que l’avis des femmes ne comptait pas. Une fois que les derniers hommes sortirent, elle s’avança vers le vieux sage :
— Hototo, moi je vais rester.
— Pourquoi une telle folie, Anne ?
— Je viens du même continent que ces conquistadors, je pourrais leur expliquer qu’ils se trompent et qu’ils aillent chercher les vrais responsables ailleurs.
— Je maintiens que c’est stupide… mais comme tu ne m’écouteras pas…
La femme s’approcha alors du vieil indien, lui fit face, s’accroupit et le fixa de ses beaux yeux bleus. Elle est grande et fine. Levant bien haut les coudes, elle tressa ses longs cheveux blonds dans le cou sans le quitter du regard. Elle lui montrait par ce geste qu’elle reprenait les rites des Européens et qu’elle était résignée.
— Ne t’inquiète pas, Hototo, ta tribu m’a recueilli et a adopté ma fille, je lui dois bien ce sacrifice.
#
Une heure passa, les Espagnols attendaient patiemment les indications des éclaireurs pour entrer en action. Malgré leur habitude du combat, ils se méfiaient des fléchettes enduites de curare qu’ils n’entendaient pas arriver. Ils surveillaient inutilement la végétation avec inquiétude, le soleil s’était couché et une noirceur totale régnait sous les épaisses frondaisons.
L’ordre d’attaquer raisonna bientôt dans la trouée : les soldats avaient bloqué au mieux les sentiers qui donnaient accès à la forêt, et allumé des feux pour illuminer la clairière, toutefois, ils ne virent aucun fuyard tenter de forcer le passage, et les lieux se révélèrent rapidement déserts. Les plus farouches Indiens restaient cachés à l’orée du bois, se préparant à riposter si nécessaire. Leur vision était plus habituée à l’obscurité et leurs flèches sauraient trouver leur chemin. Les armures légères des soldats leur protégeaient le thorax, malgré cela les archers adroits parvenaient à les atteindre au cou, entrainant une mort certaine presque à chaque fois. Pour cette raison, les assaillants patientèrent encore, demeurant accroupis derrière leurs boucliers improvisés afin de s’assurer que la clairière soit déserte. Ils tirèrent des coups de feu à l’aveugle en direction des fourrés pour leur faire comprendre qu’ils se doutaient de leur présence, avant de commencer à fouiller le village.
Il ne se composait qu’à peine d’une huitaine d’abris, répartis autour du grand carbet, ce qui suggérait un faible nombre d’habitants. Les soldats qui constituaient la troupe étaient presque déçus de ne pas avoir à combattre, et certainement de ne pas trouver de jeunes filles à violer.
Le carbet de belle taille qui trônait au centre est celui dans lequel la tribu passe l’essentiel de son temps et s’adonne aux activités communes. Les enfants y jouent avec les Matoutou, ces grosses mygales nonchalantes qui terrifient les Européens, pendant que leurs mères boucanent la viande ou mastiquent le manioc pour fabriquer la bière traditionnelle : la cachiri. Des agoutis, petits rongeurs apprivoisés, trainent autour des abris avant d’être consommés lorsqu’ils sont suffisamment gras.
— Venez voir ma découverte, lieutenant ! lui spécifia son second qui revenait de sonder l’endroit.
Le gars le guida jusqu’à un panneau qui offrait une protection dans un angle de la bâtisse, chose exceptionnelle pour ces Indiens qui n’édifiaient pas de cloisons. Baissant sa torche pour indiquer l’entrée, le gars guettait la surprise de son chef avec une certaine satisfaction, sûr de son effet.
Orenalla entrebâilla un rideau de lianes tressées pour regarder à l’intérieur.
— Ça alors, qui aurait pu prédire une telle rencontre ? laissa échapper l’officier en pénétrant dans l’espace restreint.
Assise sur des feuilles de palmes afin de s’isoler de la terre, se trouvait une femme éclairée par une torche qui dégageait une odeur tenace de graisse animale. Ses yeux d’un bleu intense ensoleillaient un visage couvert de symboles. Elle se présentait nue, si ce n’était un petit pagne qui ne dissimulait pas un corps ferme et parfaitement proportionné.
Celle-ci ne paraissait pas impressionnée le moins du monde par les soldats espagnols.
— Une blanche chez ces sauvages, c’est inattendu ! commenta Orellana.
— Vous êtes observateur lieutenant, bravo, répondit-elle.
— Et de surcroît, qui pratique notre langue, certes mal, mais tout de même ! Nous allons de surprise en surprise, décidément. Que fais-tu là alors que les autres se sont enfuis comme des lâches ?
— Je suis chamane et je devais vous avertir que vous étiez dans l’erreur en pourchassant ce peuple, ils n’y sont pour rien dans l’attaque de cet après-midi. En revanche, si vous donnez la mort à des innocents en connaissant la vérité, vous vous exposez à des dangers considérables. Les esprits de la forêt se sentiront offensés par vos agissements.
— En attendant que tes esprits arrivent pour me manifester leur courroux, tu vas commencer par venir avec nous, jolie plante.
L’officier attrapa sa prisonnière par sa longue natte blonde et la traina à l’extérieur du réduit. Elle se débattait comme une furie ; ça amusait nettement les gars qui n’avaient pas vu de femmes blanches depuis des mois, et appréciait ce corps ferme qui se dévoilait dans la lueur des torches.
— Vas-tu finir par m’apprendre qui tu es, ou vas-tu jouer aux devinettes jusqu’à ce que je te torture ?
— Lâchez-moi d’abord, et je vous le dirais éventuellement, espèce de brute stupide ! cracha-t-elle dans un espagnol rudimentaire.
— Pour vous vous échappiez, vous rêvez ma belle ! Ligote-la, José. On la ramène au bivouac pour l’interroger à tête reposée.
Les conquistadors retournèrent le village, cependant, comme prévu, ne saisirent rien de bien intéressant. La nourriture découverte leur permettrait au moins d’améliorer le repas du soir sans effort. Le lieutenant Orenalla n’avait pas survécu aux combats féroces de la conquête de ce continent par hasard. Il était avant tout un soldat préparé à la guerre, et savait pertinemment que la survie ne dépendait parfois que de détails. Il avait parfaitement enregistré l’avertissement de la femme concernant l’attaque des embarcations et s’en référa à ses subalternes.
— Messieurs, nous ne devons pas négliger le fait que cette femme nous ait dit la vérité. D’ailleurs, si la tribu qui la recueillait s’était montrée hostile, peu probable qu’il l’aurait laissé en vie et qu’il n’essaie pas de nous harceler de nouveau dans la clairière. Notifiez aux hommes d’armes qu’ils entretiennent des brasiers toute la nuit et répartissaient des patrouilles au pourtour du bivouac. Je vais tâcher d’en savoir davantage en interrogeant cette drôle d’Indienne.
Le campement sera bientôt sécurisé, il devrait être tranquille pour un moment et réclama qu’on lui amenât la prisonnière.
— Bien ! chère madame, je crois que vous pouvez comprendre mon étonnement de vous trouver là, en plein milieu de la forêt du Nouveau Monde. J’imagine que votre aventure doit être cocasse, demanda le lieutenant en admirant les formes de la femme que son modeste pagne ne dissimulait guère.
— J’accompagnais une mission de chercheurs français. Notre expédition se trouvait encore dans le Nord. Seuls des scientifiques encadrés de quelques malheureux combattants la composaient. Sans nous en apercevoir, nous nous sommes retrouvés sur le territoire des « Mbaya ».
Ces combattants étaient l’une des rares tribus osant défier la domination espagnole. Ils dressaient les chevaux perdus des conquistadors, ce qui leur attribuait une grande mobilité et accentuait leur caractère guerrier. Ils pensèrent que nous venions les envahir, tuèrent nos soldats après une cérémonie horrible et nous firent prisonniers. Les hommes, dont mon mari, furent battus et torturés, pourtant j’étais enceinte, et même ces bouchers sanguinaires respectaient les femmes qui portaient un enfant. Dans un monde où la mort guette derrière chaque tronc, ils estimaient ne pas avoir le droit d’enlever la vie à un être innocent et me confièrent aux femmes de la tribu. Je me retrouvais alors entourée de filles rieuses qui paraissaient intriguées par mon accoutrement de blanche. Un instant plus tôt, j’étais indifférente à ce qui pourrait advenir de mon existence, et ces femmes me déshabillèrent avec une grande douceur. Par la suite, quand je parviendrai à comprendre leur langue, elles m’expliqueront que les vêtements révulsaient les hommes et que leur geste avait eu pour but de la préserver de leurs colères. Je vécus une première nuit nue, aux yeux de tous et transits de froid. Par la suite, elles m’emmenèrent à des cascades pour me laver, car elles considéraient que les Européens étaient sales et attiraient les prédateurs par leurs odeurs de transpiration. À partir de ce moment, j’eus le droit de m’assoir avec elles autour des feux du soir et de partager leur vie. Si leurs hommes étaient féroces, elles se montraient douces, toujours calmes et silencieuses, si ce n’est les journées qu’elles passaient au bord de l’eau pour pêcher et s’occuper de leurs corps auxquels elles apportaient un grand soin. Elles m’apprirent en riant à utiliser des végétaux qui ressemblaient à de la mousse pour apaiser les douleurs et les marques de ma grossesse. Quand des alertes survenaient dans la vie du camp, elles étaient obligées de se rendre dans des cavernes et attendre que les guerriers reviennent de combattre de possibles intrus. Sinon, elles n’avaient d’autres grands plaisirs que de se plonger dans les eaux tièdes de cascades isolées. La vie était simple, jusqu’à ce que vint mon accouchement. S’il se déroula sans souci, les femmes changèrent de comportement, les rires fusèrent moins souvent et je surpris un soir l’une d’entre elles dont j’avais fait une amie qui pleurait. Elle m’expliqua qu’à partir du moment où j’étais libéré et que mon enfant était une fille, je ne servais plus à rien à la tribu. Le sorcier avait décidé que je serais mangé à la prochaine lune. Ces sauvages considèrent ce fait comme une forme de respect, ils espèrent puiser vos qualités dans vos chairs.
Afin de sauver ma vie, elles me mirent sur une pirogue et me laissèrent fuir une nuit avec ma fille. Elles m’indiquèrent que les courants devraient me mener vers des villages pacifiques. Voilà comment je finis par tomber sur une famille de Wayana qui pêchait. Ces Indiens m’ont recueillie et acceptée dans leur groupe.
— Recueillie ? Pas tuée, pas bouffée ? J’ai du mal à avaler votre histoire !
— Je vous assure ! En tout état de cause, ces tribus ne consomment pas de viande humaine, c’est une légende. Ce sont des Wayana, ils éludent la guerre, sauf pour se défendre.
Ce sont les Waiapi qui exterminent dans cette région. L’agression de votre expédition est certainement leur œuvre, croyez-moi ! Ils ont quitté leurs régions du Nord pour éviter les agissements de vos missionnaires qui voulaient les convertir de force. Depuis, ils désirent s’emparer de nos territoires et assaillent tous les clans.
Le lieutenant lui renversa la tête en lui tirant brutalement les cheveux, et reprit :
— N’abusez pas de ma patience ! Depuis combien de temps vivez-vous ainsi ?
— Un peu plus de deux ans, je présume… environ…
— Et personne n’a songé à vous retrouver ?
— Je ne pense pas, j’accompagnais mon mari qui était dessinateur officiel et croquait les animaux et les plantes découvertes au fil de l’expédition. Nous n’étions point des gens éminents, notre disparition ne préoccupait pas les autorités au point d’organiser des recherches. Je vous remémore que nos pays étaient en guerre et que la France ne souhaitait certainement pas affronter la flotte espagnole pour sauver quelques pauvres scientifiques.
— Bien, je veux bien croire en ta fable. J’aurai besoin de l’avis du royaume avant de décider de ton sort. Les conflits demeurent d’actualité entre nos deux nations, tu es de ce fait une prise de guerre. Par conséquent, en attendant, tu resteras attachée à ma tente et nous te ramènerons à un comptoir espagnol pour être fixés sur votre sort. Tu es tout de même, je te le rappelle, complice d’une tribu qui a assassiné des conquérants, ça vaut normalement la peine de mort sans jugement.
— Mais je suis française, je ne suis pas concernée par les lois d’Espagne. Encore moins avec les Indiens, même s’ils m’ont accepté. Aucune autre solution ne me permettait d’espérer m’en sortir.
— C’est le Portugal et l’Espagne qui ont découvert et gèrent à présent ce nouveau continent. Vous, les Français et les Anglais, êtes arrivés après nous et exploitez les fruits de notre travail. Au diable les profiteurs que vous êtes !
— Ne vous fâchez pas, lança-t-elle en baissant les yeux.
— Quel est votre nom ?
— Anne… Anne Bonlieu… !
Orellana abandonna la femme après avoir fait signe à un soldat de l’attacher fermement.
Tout autant que la perte de ses deux hommes à la fin de la journée, la capture de cette femme le contrariait au plus haut point. Pourquoi s’encombrer d’une prisonnière de peu de valeur ?
Il n’avait pas réussi à situer le fameux Eldorado malgré ces mois de recherches et le roi ne lui pardonnerait peut-être pas cet échec. Le monde entier espérait la découverte de cette ville mystérieuse. Un immense empire comme l’Espagne se devait d’être le premier à fouler ses rues.
La nuit bruyante était bien avancée, la fumée des feux de bois humide avait permis à la troupe de manger et se reposer un peu, tout en maintenant les fauves à distance. Les alentours paraissaient calmes si ce n’est le tintamarre des grenouilles et des grillons.
Les adjoints du chef avaient disposé des gardes au pourtour des guitounes comme convenu pour anticiper une action revancharde des Indiens. La pleine lune éclairait le campement, un sentiment de sécurité se dégageait grâce à sa clarté.
Le lieutenant se dit que finalement, quitte à s’embarrasser de cette femme, autant qu’elle serve à quelque chose !
— Viens dans ma tente, dépêche-toi ! ordonna-t-il en la détachant du piquet dont elle était ligotée.
Anne le suivit sous l’abri. Elle ne nourrissait plus d’illusions sur la conclusion des évènements. Depuis qu’elle avait erré dans cette jungle, elle avait compris que les notions de couples et de sexe étaient différentes sur ce continent et ne redoutait plus les hommes.
— Enlève ce pagne minable !
— Je ne peux pas, vous m’avez attaché les mains…
La rapidité avec laquelle ce dernier sortit son couteau la fit sursauter. Elle craignait le pire, mais celui-ci se contenta de trancher ses liens.
— Allez, reste sage. Sinon, je te rattache et t’offre à mes soldats.
Elle lui obéit parce que consciente qu’elle ne pouvait pas reculer l’issue fatale de ce moment. Elle soutenait son regard pour que l’homme comprenne qu’elle n’avait pas peur de lui.
— Tourne-toi !
Il la pénétra sans précaution puis la fourragea de toute sa hargne, brisant la petite table sur laquelle il l’avait appuyé. Le conquistador n’avait pas côtoyé de femme depuis des mois. Si certains des envahisseurs profitaient des rencontres avec des tribus pacifiques pour passer la nuit avec des femmes, Orenalla ne voulait pas toucher ces infidèles. De fait, l’excitation abrégea rapidement la torture de la captive.
Elle s’était à présent blottie au pied du lit de camp, et l’observait, redoutant des réactions brutales maintenant qu’il avait assouvi son désir.
— Tu peux dormir là si tu te tiens à carreau ! Sans quoi, je te livre à mes hommes. La nuit que tu passerais serait pénible, si tu y survivais.
— Vous n’êtes que des assassins. Vous ne respectez rien ni personne !
— Je n’ai même pas envie de te contredire. Tu es resté dans ces forêts depuis bien trop longtemps, mangeant des fleurs et embrassant les arbres, chantant des louanges aux oiseaux et en effleurant les pierres. Toi et tes sauvages ne pouvez concevoir quoi que ce soit aux complexités du monde moderne. La vie change, de plus en plus vite, et faire partie des premiers est indispensable si l’on veut saisir sa chance. Tu t’en rendras compte en revenant à la civilisation, si tu y retournes un jour.
— Je suis une chamane, je pressens les choses qui vont arriver. Je vois que les Indiens finiront par vous défier et beaucoup d’entre vous mourront dans ces combats. Vous ne reverrez certainement pas non plus votre pays. La forêt ne vous laissera pas vous enfuir avec ses richesses.
Elle parlait dans le vide, le lieutenant sommeillait déjà, épuisé de son coït. Il en avait relâché sa vigilance. Il n’avait pas jugé bon de la rattacher, convaincu que la peur des gardes à l’extérieur et la menace de l’offrir en pâture à sa troupe suffiraient à la faire se tenir tranquille. Lorsque le souffle de l’homme l’assura qu’il dormait profondément, elle en profita pour se glisser sous la toile de la tente, et rampa jusqu’à la forêt. Les éclaireurs de la tribu étaient là, camouflés dans la végétation, attendant une erreur de leur ennemi pour pouvoir intervenir.
Elle leur fit signe de la suivre. Une fois à l’abri, elle entreprit de les persuader qu’il était inutile de vouloir s’en prendre à ces hommes. Ces soldats possédaient un armement imposant et ils repartiraient bientôt, comme les Espagnols pratiquaient toujours.
Seules les richesses de toutes sortes les intéressaient, ils ne gâcheraient pas un temps précieux à retrouver des Wayana dépourvus.
Néanmoins, Anne ne pouvait deviner que les guerriers n’avaient pas respecté les conseils de Hototo, et débordant de colère, avaient assouvi leur désir de revanche en tuant une patrouille imprudente. La grande femme blanche les impressionnait tellement qu’ils n’osèrent pas lui avouer cette vengeance.
Une colère contenue emplit l’officier lorsqu’il découvrit au matin que sa tolérance avait favorisé la fuite de la prisonnière. Tandis que, juste après, des éclaireurs vinrent lui annoncer la funeste nouvelle des soldats récupérés morts aux abords du village, il explosa. Nul ne devait pouvoir se moquer des responsables de la couronne espagnole et de ses représentants.
Ces tribus finissaient par le lasser. Elles attaquaient leurs convois sans cesse, arrivent à tuer un ou deux hommes et s’évanouissaient dans la forêt chaque fois. Ces peuples ne se soumettaient pas à une autorité fixe ; les groupes fusionnaient et se défaisaient. Cette instabilité, facilitée par leur mobilité extrême le long des voies d’eau, les rendait ingouvernables, du moins selon les critères de la vieille Europe.
Orellana était soldat et ne connaissait que la guerre conventionnelle, les combattants se faisant face, sur un champ découvert, prévu par les antagonistes par avance. Il estimait que des codes devaient être observés, et il espérait que voir ces sauvages les accepter un jour.
Orenalla donna des ordres pour que le campement soit gardé de jour comme de nuit. Des sentinelles dormiront dans les pirogues pour écarter la possibilité qu’elles soient volées et il fît abattre des arbres afin de dégager la zone, et que de grands brasiers éclairent la nuit pour éviter toute intrusion. Il convoqua ses plus fidèles seconds, et ordonna qu’ils organisent des escouades pour fouiller la forêt et tâcher de capturer des sauvages que l’on pendrait à titre d’exemple.
Le soir grandissait et le lieutenant avait ouvert sa tente en grand pour profiter des dernières lueurs du jour et rédiger ses notes de voyage. Il tenait à composer une lettre qui le précèderait à la cour dans laquelle il dépeignait son épopée sous un jour positif, certes sans omettre de décrire les difficultés que présente ce pays.
Il venait de s’interrompre pour réfléchir, ne négligeant pas qu’il devait justifier sa fuite et mettre en valeur la nécessité de sa désertion. Pour ce faire, l’exigence de dévoiler l’incompétence de la famille Pizarro paraissait évidente ; il ne pouvait oublier qu’ils étaient cousins et ne voulait pas que ses mots semblent exprimer de la rancune.
Des torches éclairèrent la forêt au loin, et attirèrent son attention. Il arrêta d’écrire en fixant ces lueurs. La patrouille de José, son vieux compagnon, sortit des frondaisons en poussant des Indiens entravés les uns aux autres à grands coups de baïonnettes. José vint au-devant d’Orenalla.
— Nous avons débusqué ces trois gaillards à force de patience. Où vous aviez raison, c’est que la pêche peut se montrer une technique imparable. Nous nous sommes recouverts de feuillages et avons attendu ainsi des heures, jusqu’à ce que ceux-là passent à portée de mousquets. Bien sûr, je ne comprends pas le moindre mot de ce que baragouinent ces gars. J’ose espérer que votre lexique permettra de pallier ce problème.
— C’est parfait, José. Je vais les interroger sans perdre de temps. Veille à ce qu’ils soient ligotés à des arbres proches, je termine une missive à l’intention de la cour et je vous rejoins.
Il retrouva rapidement sa lettre, une idée venait de faire jour. Il pensait qu’il fallait mettre en valeur la dégradation de la raison de Pizarro et son désir de régner sur ces terres. Qu’il se hasarde à se prendre pour un roi déclencherait certainement le courroux de l’empereur sans coup férir. Cela fait, il revint vers les captifs désormais attachés aux arbres qui encadraient le campement. José se tenait là, accompagné d’homme équipé de torche afin que les prisonniers soient bien visibles et que les reflets des armes que les soldats brandissaient sous leurs nez les impressionnent.
— José, avais-tu vu que celui-ci saignait de la cuisse ?
— Oui, il a pris un coup de mousquet en essayant de s’enfuir.
— C’est ennuyeux, il risque d’attirer vers nous tous les prédateurs de la région. Au mieux, les fourmis auront commencé à attaquer ses jambes avant l’aube, et il ne nous sera plus très utile. Pendez-le à l’écart sans plus tarder.
Orenalla exigea de la lumière pour bien observer les traits des sauvages et déceler l’âge qu’ils pouvaient avoir. Il les interrogea sur ce détail, mais voulait s’assurer qu’ils ne mentent pas. Dans la plupart du temps, ils ne le savaient pas eux-mêmes, les années n’ayant pas pour eux l’importance que leur attribuaient les Européens. Après un examen attentif, il déclara :
— Pendez également celui-là demain matin au bord de la rivière de façon que les autochtones de passage comprennent la colère de l’Espagne. Ajoutez-lui une croix de bois pour exposer à ces gueux comment s’exprime la fureur de notre dieu. Concernant le dernier, entravez-le et menez-le à ma tente.
De deux jours, on ne vit pas le lieutenant quitter sa tente dans laquelle il s’était enfermé avec le prisonnier. De temps à autre, des cris jaillissaient de sous la toile pour qu’on lui amenât à boire ou de quoi se restaurer, mais aussi des hurlements de douleur montaient vers la canopée fréquemment, indiquant que le supplicié ne se montrait pas coopératif. En fin d’après-midi du second jour, Orenalla sortit de son antre et apostropha José.
Il l’entraina à l’écart, suivant la rive du fleuve et s’installèrent sur un tronc couché, propice à la méditation. Orenalla avait préparé un long exposé et développa les raisons qui lui faisaient prendre sa décision. Il avait tout prévu pour donner du poids à ses arguments, citant la grandeur du royaume, et la richesse envisageable pour les hommes.
— L’autochtone m’a confié que les tribus de la région racontent qu’une cité se dressait en aval et je désire remonter le fleuve pour m’en assurer. Néanmoins, nous ne pouvons utiliser le brigantin pour espérer mener à bien cette expédition, ce bateau trop lourd serait impossible à manœuvrer contre les courants. Profitons de cette opportunité pour écarter les hommes d’armes, ils refusent de s’adapter à la forêt, ne sachant pas pêcher ou reconnaitre les plantes comestibles, ils entraveraient notre progression plutôt que de l’encourager.
José effectua le tour des hommes pour connaitre les volontaires et sélectionna les meilleurs rameurs. Orellana lui avait également demandé d’informer les soldats que leur mission serait de suivre les courants afin d’avertir les autorités de leurs avancées. Le commandant de la garde vint consulter le lieutenant pour comprendre les raisons de cette décision.
— J’ai préparé des lettres que vous remettrez au gouvernement. Ces missives justifient notre choix d’explorer la région pour dénicher la ville mythique. Ni vous ni moi ne sommes marins, mais avez-vous bien observé le fleuve ?
— Le fleuve ? Non, mon lieutenant, et pourquoi cette question ? Elle semble loin de nos préoccupations.
— Eh bien, ça tombe bien, l’heure devrait être propice, dit Orenalla en ramassant un petit morceau de bois et en s’approchant des eaux. Regardez attentivement, ajouta-t-il en lançant la brindille. Que remarquez-vous ?
L’air goguenard du soldat suffit à faire comprendre que le bourru ne voyait rien du tout, ce qui entraina un souffle désespéré de l’officier.
— Vous n’êtes qu’un âne. Constatez que le bois remonte au lieu de continuer à descendre. Un courant inverse, et aussi puissant que celui du fleuve provoque ce phénomène chaque jour. Ce fait indique que nous nous approchons de la mer et ce sont ses marées qui dominent la descente de la rivière. Vous devriez rejoindre une côte sans trop tarder.
Pour le moment, Orellana voulait remonter jusqu’à l’Araguaia en empruntant le Tocantins, l’important fleuve qu’il avait descendu en partie. D’après ces derniers renseignements, il reçoit de nombreux petits rus qui pourraient mener à la ville convoitée.
Les tribus parlaient d’une cité sur les bords d’un lac, malgré cela, personne jusqu’à présent ne l’avait trouvé. Probablement que ce lac ne se formait qu’aux saisons des pluies, engendré par les crues des rivières environnantes. Le lieutenant Francisco pensait que les Indiens faisaient une parabole et qu’en fait, une partie du Paraná s’élargissait sur des kilomètres à une jonction avec un de ses puissants affluents. Comme plusieurs versions de la légende relatent qu’un serpent gigantesque protégeait ce lac, ce détail indique sûrement que quelque chose de précieux s’y cachait.
Le soir arriva, toujours à heure fixe, comme le veut la vie sous l’équateur. Le feu été allumé, rituel autour duquel les garçons boivent en se racontant leurs aventures, qu’ils soient autochtones ou conquérants. Les hommes étaient inquiets ou joyeux, selon qu’ils rentraient ou poursuivaient le voyage, tous attendaient les arguments de leur chef. Francisco se leva pour entamer son discours qu’il souhaitait persuasif afin de rassurer sa troupe.
— Mes amis, cette fois encore, nous allons nous séparer. Ceux qui descendront le fleuve, je l’espère, retrouveront la civilisation et pourront conter nos aventures afin qu’elles parviennent jusqu’aux oreilles du roi. Pour les nombreux autres, nous allons remonter le fleuve pour découvrir un lieu que les Indiens nomment : « le grand lac ». La culture amérindienne étant uniquement orale, les modifications et les paraboles enrichissant les légendes au fil des années, la véracité des indications reste délicate. Depuis que nous avons mis le pied sur ce continent, nous n’avons de cesse de chercher cette cité d’or. Cette fois, à force de recoupement, les mythes paraissent s’accorder et je veux en avoir la certitude. Voilà les raisons de mon entêtement.
— Lieutenant, que disent ces légendes ?
— Elles mentionnent constamment une grande étendue d’eau et un serpent qui garderait les lieux. Plus haut, en amont, se trouve la jonction de plusieurs fleuves qui forment un vaste lac, dont un affluent possède des méandres très importants qui rappellent les ondulations du reptile.
— Qui vous a relaté cette légende, mon lieutenant ? Ne pensez-vous pas que ces sauvages nous promettent des richesses pour nous voir partir de leurs territoires ?
— Non, car sinon, les mythes ne se ressembleraient pas autant.
— Racontez-nous, j’aimerais connaitre cette anecdote.
Un murmure approbateur s’éleva de l’assistance, ne laissant pas le choix à Orenalla.
— Entendu. Alors, je m’assois… il se dit que ce serpent gigantesque résiderait dans les profondeurs du fleuve. Ses yeux fluorescents terrifiaient les personnes qui croisaient son chemin. L’histoire la plus fréquente narre qu’une jeune femme d’une tribu amazonienne, enceinte du serpent Bouin, aurait donné naissance à des jumeaux ; un garçon appelé Honorato et une fille, nommée Maria Caninana. Effrayée par l’apparence de ses enfants-serpents, elle les jeta dans le fleuve.
Les deux enfants avaient deux personnalités distinctes. Tandis que le garçon possédait un cœur pur et rendait toujours visite à sa mère, Maria, quant à elle, en colère contre les actes de sa mère, ne la revit jamais.
La jeune fille faisait preuve d’un fort tempérament, elle terrorisait sans cesse les populations et les animaux. Elle faisait chavirer les bateaux.
Son frère, fatigué de son comportement, se résolut un jour à la tuer afin de mettre un terme à la souffrance de nombreux être humain.
Il se dit aussi que les nuits de pleine lune, Honorato se métamorphosait en mortel et pouvait ainsi aller sur la terre ferme. Hélas ! Lorsque se terminait le cycle, il s’en retournait à nouveau dans les fleuves.
Pour rompre le charme, une personne devait parvenir à blesser le serpent à la tête et lui verse du lait dans son énorme bouche. Or, tout le monde était effrayé lorsque celui-ci reprenait son apparence de reptile et personne n’eut le courage de tenter l’expérience, jusqu’au moment où un vaillant soldat le libéra enfin de la malédiction. Honorato put ainsi poursuivre sa vie sur la terre ferme comme n’importe qui, et être en définitive avec sa famille.
— La contradiction semblait évidente : si la mauvaise sœur avait été assassinée par son frère, plus aucun prédateur n’empêcherait d’atteindre le trésor. Remarqua un piroguier.
— Tu as raison, néanmoins une histoire indienne est tirée de faits réels : celle du roi doré (el Dorado). Elle se diffuse jusque de l’autre côté de la montagne : ce roi se recouvrait de poudre d’or et se baignait dans le lac tous les matins. D’autres ajoutaient que de l’or et des bijoux précieux étaient jetés dans le lac en vue d’apaiser un dieu qui vivait dans les profondeurs.
La concordance de ces deux légendes a attiré mon attention, me poussant à aller vérifier.
Voilà ! vous savez tout. Nous partirons demain au lever du jour. Reposez-vous et mangez bien, car la remontée du fleuve risque de s’avérer pénible.
De brefs adieux eurent lieu, certains souhaitaient que les partants avertissent leurs familles de leur excellente santé et d’une fortune assurée à leur retour. Une messe improvisée fut donnée en mémoire des hommes tués lors de la dernière attaque. Les corps pendus des Indiens capturés, qui commençaient à se décomposer sous l’effet de la chaleur, encadraient les tombes des Espagnols, offrant une macabre mise en scène.
[1] Menuisiers de marine






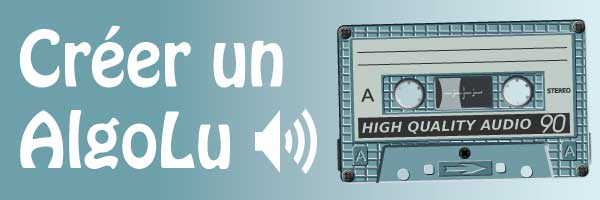
































Texte soigneusement documenté. j’attends l’épisode 2
Merci. J’en étais venu à oublier que j’avais mis ce texte en ligne, tant il n’y avait pas de retour. Je vais donc m’empresser de vous proposer la suite, sachant que c’est un (presque) premier jet.